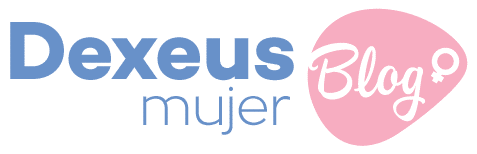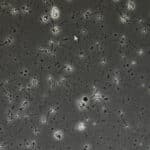En général, les tests de fertilité sont proposés chez les patientes qui rencontrent des difficultés à concevoir, mais ils peuvent aussi s’avérer utiles si vous avez des antécédents de fausses couches ou d’autres problèmes gynécologiques dans la famille, si vous envisagez de repousser la maternité ou simplement si vous n’excluez pas la possibilité d’avoir un enfant à l’avenir. L’objectif est de vérifier que tout fonctionne correctement et d’évaluer vos chances d’avoir un enfant.
Les troubles de la fertilité sont plus fréquents qu’on ne le pense : ils touchent environ 15?% des couples et, dans 30?% des cas, ils sont dus à une combinaison de facteurs d’origine féminine et masculine. L’avantage de faire un bilan en amont, c’est de pouvoir poser un diagnostic et commencer un traitement plus rapidement si un problème est détecté, et de disposer de plus de temps pour prendre une décision.
Quels sont les examens réalisés ? Sont-ils longs ou complexes ?
« En règle générale, et sauf indication contraire, les examens sont simples et les résultats sont disponibles en quelques semaines », explique le Dr Marina Solsona, spécialiste en procréation médicalement assistée chez Dexeus Mujer. « Une première consultation permet de faire le point sur l’état de santé, l’alimentation, le mode de vie et les antécédents médicaux et familiaux de la patiente. »
Un bilan sanguin avec une analyse hormonale est également prescrit, ainsi qu’un examen physique, un frottis (pour exclure toute infection ou lésion cellulaire) et une échographie transvaginale. Chez les patientes de plus de 40 ans, une mammographie ou une échographie mammaire peut aussi être recommandée. Si vous êtes en couple avec un homme, notre centre vous propose la possibilité de réaliser un bilan de fertilité en couple.
Quels sont les paramètres les plus importants ? Et sur quoi se basent les experts pour poser leur diagnostic ?
Chaque cas est évalué individuellement, et le choix des examens est donc toujours adapté aux besoins spécifiques de chaque patiente. Cela dit, certains examens sont systématiques et font partie du protocole standard. En voici les principaux :
1. Évaluation de la réserve ovarienne
Elle repose sur une échographie transvaginale à réaliser entre le 3e et le 5e jour du cycle menstruel. L’objectif est de compter le nombre de follicules présents dans chaque ovaire. Les follicules sont des poches de liquide, contenant chacun un ovocyte immature. Si plus de 10 follicules sont observés au total (dans les deux ovaires), la réserve ovarienne est considérée comme bonne. Un comptage égal ou inférieur à 4 follicules par ovaire, ou à 7 au total, est considéré comme une faible réserve ovarienne. Cela ne signifie pas pour autant qu’une grossesse soit impossible ou que les ovocytes soient de mauvaise qualité.
2. Bilan hormonal : AMH, LH, FSH, œstradiol et progestérone
Un bilan hormonal est essentiel pour détecter d’éventuels troubles endocriniens pouvant affecter le cycle menstruel et pour évaluer la réserve ovarienne. Les principales hormones analysées sont :
– Hormone antimüllérienne (AMH) : produite par les follicules, cette hormone est un bon indicateur de la réserve ovarienne. Une AMH élevée (supérieure à 3,1 ng/ml) reflète une bonne réserve. À l’inverse, un taux inférieur à 1 ng/ml indique une réserve diminuée, et donc une fenêtre de fertilité plus courte.
– FSH, LH et œstradiol : la FSH (hormone folliculo-stimulante) stimule la croissance et la sélection des follicules ; la LH (hormone lutéinisante) déclenche l’ovulation ; et l’œstradiol est l’hormone produite par les follicules au fur et à mesure de leur maturation. Ces hormones fournissent des informations utiles pour évaluer le potentiel de fertilité. En général, une FSH supérieure à 10 mUI/ml et/ou un œstradiol basal supérieur à 80 pg/ml peuvent indiquer une faible réserve ovarienne. Cela dit, ces valeurs peuvent fluctuer d’un cycle à l’autre (davantage que l’AMH).
– Progestérone : sécrétée par l’ovaire après l’ovulation, cette hormone permet de confirmer que l’ovulation a bien eu lieu ou de détecter une anovulation. Un taux supérieur à 5–10 ng/ml est considéré comme normal.
3. Échographie transvaginale
Elle permet d’examiner les organes reproducteurs (ovaires, utérus) et de détecter d’éventuelles anomalies telles que des fibromes, des polypes, des kystes, etc., ou des problèmes structurels, comme des malformations ou des dysfonctionnements de l’utérus ou du système reproducteur. Cet examen permet également de réaliser le comptage de follicules antraux mentionné précédemment pour évaluer la réserve ovarienne.
4. Examen physique
Il consiste à examiner les seins et à effectuer un toucher vaginal pour vérifier qu’il n’y ait pas d’anomalies. Cet examen est réalisé en consultation et correspond au contrôle gynécologique habituel pratiqué lors des bilans annuels.
Autres examens de fertilité chez la femme
Dans certains cas, des examens complémentaires peuvent être nécessaires. Voici les plus fréquents :
Caryotype : il s’agit d’un test génétique qui analyse le nombre et la structure des chromosomes, afin de détecter d’éventuelles anomalies chromosomiques pouvant provoquer une infertilité, des fausses couches à répétition ou des complications pendant la grossesse.
Hystéroscopie : cette technique consiste à introduire une caméra par le vagin et le col de l’utérus pour visualiser l’endomètre. Elle permet de détecter la présence de fibromes, de polypes, de malformations utérines, de résidus après une fausse couche ou de lésions pouvant indiquer un processus cancéreux ou précancéreux.
Biopsie de l’endomètre : indiquée en cas d’échecs d’implantation afin d’évaluer la réceptivité endométriale. Elle consiste à prélever un petit échantillon de tissu de la muqueuse utérine (l’endomètre) pour l’analyser. Cela permet de diagnostiquer d’éventuelles infections, des altérations cellulaires ou des anomalies telles que l’hyperplasie endométriale.
Hystérosalpingographie : cet examen, un peu plus complexe, est similaire à une radiographie avec injection d’un produit de contraste iodé par voie vaginale. L’objectif est de vérifier s’il existe une obstruction des trompes de Fallope ou une anomalie utérine qui empêcherait les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule et de le féconder. Il existe aujourd’hui une alternative : la salpingosonographie, qui utilise des ultrasons au lieu de rayons X pour obtenir des images.