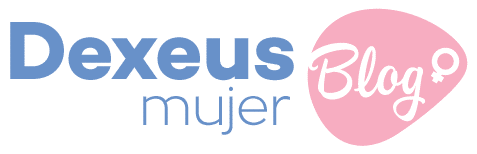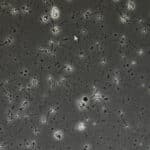À moins d’antécédents familiaux d’infertilité, peu de femmes imaginent pouvoir rencontrer des difficultés pour concevoir. Pourtant, si vous essayez de tomber enceinte depuis un an sans succès, il est recommandé de consulter un spécialiste. Et si vous avez plus de 35 ans, il est conseillé de le faire plus tôt, après six mois. En effet, à partir de cet âge, la fertilité féminine diminue progressivement. Il est donc essentiel d’identifier rapidement tout éventuel problème afin d’éviter de prolonger inutilement l’attente et de perdre du temps.
Faire le premier pas en prenant rendez-vous avec un spécialiste de la PMA peut être difficile, tout comme accepter l’idée que l’on puisse avoir un problème de fertilité. Mais ce à quoi certainement personne ne s’attend, c’est que les résultats des examens de base indiquent que « tout est normal » sans pour autant fournir d’explication.
Ce type de situation correspond à ce que l’on appelle une infertilité inexpliquée ou idiopathique et reste un sujet controversé pour de nombreux experts, car l’absence de diagnostic rend plus difficile le choix de la stratégie à adopter. En gynécologie, le terme « infertilité idiopathique féminine » désigne une situation dans laquelle aucune anomalie n’est mise en évidence lors des examens médicaux de base qui permettrait d’expliquer les difficultés du couple à concevoir. Toutefois, certains spécialistes estiment que ce terme devrait être utilisé avec prudence, car certains problèmes peuvent ne pas être détectés par ces examens.
« C’est pourquoi il est essentiel de bien définir quels examens sont nécessaires avant de conclure qu’il s’agit d’une infertilité inexpliquée », explique le Dr Josep Gonzalo, spécialiste en procréation médicalement assistée et directeur du centre Dexeus Mujer de Reus.
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur ce sujet :
L’’infertilité inexpliquée est-elle un problème fréquent ?
Oui. L’infertilité inexpliquée représente environ 30 % des cas d’infertilité, bien que ce pourcentage puisse varier entre 8 et 37 % en fonction du degré d’exhaustivité des examens effectués.
Existe-t-il un profil type de patiente ?
Il n’existe pas de profil unique. Cela dit, il s’agit souvent de femmes jeunes ayant une fonction ovarienne normale, des trompes perméables et aucune anomalie utérine apparente. Néanmoins, les cas sont très variés et dépendent également du contexte clinique et géographique.
Quels examens sont inclus dans un bilan de fertilité de base ?
Les examens de base comprennent : un entretien médical approfondi portant sur les antécédents médicaux, sexuels et reproductifs ; une prise de sang avec bilan hormonal ; un examen des trompes (hystérosalpingographie ou HyCoSy) ; et une échographie transvaginale (idéalement en 3D) pour exclure toute anomalie utérine. En cas de partenaire masculin, il est également recommandé de réaliser un spermogramme selon les critères de l’OMS.
Quelles anomalies peuvent échapper aux examens de base ?
Une endométriose légère, des troubles immunitaires, des anomalies de l’implantation endométriale, ou encore certaines altérations génétiques ou épigénétiques. Ces pathologies nécessitent des examens plus spécifiques ou invasifs pour être détectées.
Quelle est la prise en charge recommandée en cas d’infertilité inexpliquée ?
Le protocole suggéré consiste à confirmer le diagnostic par exclusion et à évaluer les chances de conception naturelle. Il s’agit d’une estimation personnalisée effectuée par le spécialiste en fonction de chaque dossier. Selon ce pronostic, il peut être conseillé d’attendre encore quelques mois ou d’entamer tout de suite un traitement de procréation médicalement assistée.
Quels examens complémentaires peuvent être prescrits ?
Une analyse de la réceptivité endométriale, des tests immunologiques, des études génomiques et une laparoscopie diagnostique (uniquement en cas de suspicion d’endométriose ou d’autre pathologie utérine). Il est important de souligner que peu de ces examens reposent sur des preuves scientifiques solides et qu’ils sont généralement limités à la recherche ou à des situations cliniques particulières.
Quand faut-il envisager des tests immunologiques ?
Uniquement dans des cas bien ciblés présentant des antécédents cliniques pertinents, tels que des fausses couches à répétition, des maladies auto-immunes connues ou plusieurs échecs d’implantation. Ils ne sont pas recommandés de manière systématique dans tous les cas d’infertilité idiopathique.
Est-il conseillé de continuer à essayer de concevoir naturellement pendant un certain temps avant de recourir à la PMA ?
Oui, si les chances de conception naturelle sont élevées. D’après les modèles pronostiques, les couples ayant plus de 30 % de chances de concevoir dans les 12 mois peuvent attendre encore 6 à 12 mois avant d’envisager un traitement, ce qui permet d’éviter des interventions inutiles. Il faut également garder à l’esprit que certains changements d’habitudes peuvent améliorer la fertilité : arrêter de fumer, ne pas boire d’alcool, maintenir un poids de forme, faire au moins 30 minutes d’activité physique par jour, limiter la caféine, réduire le stress et avoir un sommeil de bonne qualité.
Quel traitement de PMA recommande-t-on en premier lieu ?
Le traitement de première intention est généralement une insémination intra-utérine avec une stimulation ovarienne légère, pendant 3 à 6 cycles. En cas d’échec, une fécondation in vitro (FIV) peut être envisagée. Le recours à l’ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes) n’est indiqué que si une infertilité masculine est identifiée.
Quels sont les résultats des différentes techniques de PMA chez ces patientes ?
Chez les patientes ayant un mauvais pronostic de conception naturelle, l’insémination intra-utérine avec stimulation ovarienne a montré de meilleurs taux de grossesse que l’attente spontanée. La FIV ne semble pas offrir d’avantages clairs par rapport à l’insémination dans ce groupe de patientes. Quant à l’ICSI, elle n’améliore pas les résultats par rapport à la FIV classique en l’absence d’infertilité masculine. En résumé, chez les patientes présentant une infertilité inexpliquée et un bon pronostic, la FIV ne donne pas de meilleurs taux de réussite que l’insémination, ce qui renforce l’intérêt d’une prise en charge progressive.
Mais y a-t-il de l’espoir ? Oui. Malgré l’incertitude qui entoure l’infertilité inexpliquée, de nombreux couples parviennent à concevoir, que ce soit naturellement ou grâce à un traitement. Les progrès de la procréation médicalement assistée et l’utilisation de modèles pronostiques permettent aujourd’hui de personnaliser les stratégies de traitement, de limiter les interventions inutiles et d’améliorer les résultats.